En somme, le problème philosophique vraiment le plus fondamental est celui de la définition de l’homme. Bien sûr, les philosophes se posent beaucoup d’autres questions, surement pas que certains animaux réalisent certaines choses que l’on pourrait, à première vue, qualifier de techniques : les nids des oiseaux, les termitières des termites, les terriers des lapins, que sais-je encore.
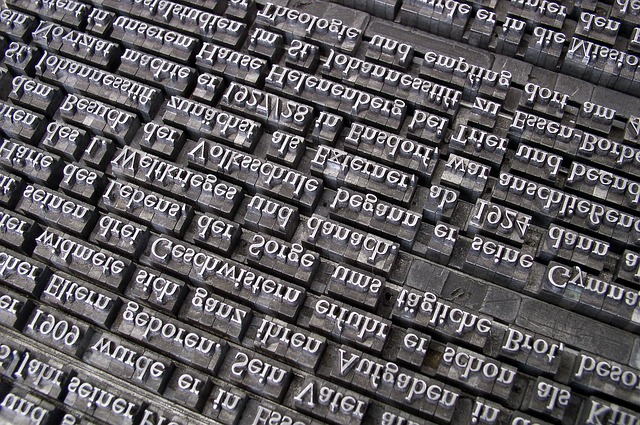
Et j’ai rappelé que l’on observe, dans leur milieu naturel, sans donc l’influence éventuelle d’un homme qui les aurait « dressés », des singes utilisant un caillou pour écraser un fruit. Mais comprenons bien que les soi-disant « techniques » des animaux n’ont pas ce caractère fondamental de la technique humaine, qui est la perfectibilité, et donc la possibilité de progrès. Le singe qui, aujourd’hui, ramasse une branche ou un caillou, le fait exactement comme ses ancêtres d’il y a mille ans ou cent mille ans le faisaient déjà. L’araignée qui tisse sa toile le fait exactement comme le faisaient les araignées de la même espèce il y a des générations et des générations. Dès que l’homme eut inventé l’outil, il inventait en même temps le perfectionnement de l’outil. Au début, certes, ce perfectionnement sera très lent, mais nous observerons, ci-après, l’accélération du progrès technique.
Langage: définition
Je crois pouvoir dire que l’idée de placer l’outil à l’origine de l’humanité est à mettre en relation avec une vision « matérialiste » du monde, alors que l’idée de chercher la spécificité de l’humain dans le langage est liée à une vision « idéaliste » des choses. Ceux qui font du langage l’origine de l’humain sont, plus ou moins consciemment, liés à l’idée — idéaliste, d’origine religieuse —de la dualité entre le corps et l’âme. Le langage serait le pouvoir de l’âme, de la partie « noble », « spirituelle » de l’être humain. Ceux qui, par contre, font de l’outil la spécificité de l’humain sont liés plutôt à une vision des choses où tout est matière, où le corps ne possède pas cette âme immortelle qui, pour les matérialistes, est une illusion. Je ne vais pas trancher, et décider entre ces deux options, totalement opposées. Ce qui me paraît certain, c’est que l’outil a changé le monde, a modifié, considérablement, la condition humaine. Ce qui est tout aussi certain, c’est que l’apparition du langage a également, en profondeur, changé les conditions de vie des hommes. Pas plus qu’on ne connaît la date, le lieu et l’auteur de l’invention de l’outil, on ne connaît le moment, l’endroit et le responsable de l’invention du langage. D’ailleurs, tout porte à admettre que l’invention ne fut pas un événement unique. Il est difficile d’admettre qu’un jour, il y a un million d’années ou cinq cent mille ans, un hominien s’est mis à parler, et qu’il a proposé à ses congénères tout un vocabulaire et une syntaxe avec distinction des verbes, des noms et des compléments ! Ce qu’admettent généralement ceux qui ont réfléchi à l’invention du langage, c’est que celui-ci s’est développé de génération en génération, pendant un long processus de perfectionnement. Il n’y eut sans doute, au début, que des cris — comme chez les animaux —puis, petit à petit, l’apparition des deux fonctions essentielles du langage : exprimer (aux autres : « communication ») ses sentiments, indiquer (aux autres : « nomination ») les choses. Les phrases du début du langage devaient signifier, en français moderne, quelque chose comme « je suis content » ou « il y a là un fruit comestible »…
Qui a inventé le langage ?
Toute une littérature existe sur l’origine du langage, comme il existe toute une littérature sur l’origine de l’outil. Mais, pour l’outil, les musées sont pleins de pierres éclatées, de pierres taillées, de pierres polies, dont parfois on connaît la date avec une assez grande précision (grâce aux méthodes de datation mises au point par les scientifiques du )0(e siècle). Il est donc possible d’élaborer des théories « sérieuses » sur l’évolution des outils, et même sur l’origine de ceux-ci. Par contre, rien de tel semble-t-il pour le langage. Nous ne possédons malheureusement aucun enregistrement des premiers cris « significatifs » des hominiens.
En 1772, l’Allemand Johann Gottfried von Herder publie Abhandlung über den Ursprung der Sprache («Traité sur l’origine du langage ») chez Christian Friedrich Voss, à Berlin. C’est le point de départ de toute une série de publications, évidemment purement spéculatives, sur ce sujet inaccessible à l’observation directe. En 1781, une publication posthume de Jean-Jacques Rousseau traite du même sujet : Essai sur l’origine des langues, où il est parlé de la mélodie et de l’imitation musicale (Genève). En 1848, Ernest Renan publie à son tour un opuscule (32 pages) sur le sujet : De l’origine du langage, chez Joubert, à Paris. En 2001, le Belge Guy Jucquois publie encore Pourquoi les hommes parlent-ils? L’origine du langage humain (Académie royale de Belgique, Bruxelles). Mais il y eut bien d’autres dissertations sur le sujet. Nous n’irons pas jusqu’à dire qu’on ne sait rien. Que l’apparition du langage soit postérieure à celle de l’outil paraît être une certitude. Mais en dehors de ce résultat, tous ceux qui, de Herder à Jucquois, ont tenté d’aller plus loin, n’ont pu élaborer que des hypothèses. Philosophes ou philologues, ils ne pouvaient que faire des phrases à partir d’idées. Les biologistes, par contre, partent, pour élaborer leurs théories, de l’observation d’objets matériels.
L’examen de plus en plus approfondi des squelettes fossiles a montré, à ces biologistes, que les premiers hominiens (de même que les singes) ne possédaient pas une disposition anatomique du pharynx et du larynx permettant l’émission de sons articulés suffisamment différents pour constituer un langage. Mais l’on ne peut guère aller plus loin dans les hypothèses en se limitant à l’examen anatomique.
L’histoire du langage
Et puis il y eut, en 1990, la découverte de la famille KE, à Londres.
Il s’agissait d’une famille d’une trentaine de personnes, vivant à Londres, dont les membres appartenaient à trois générations. À peu près la moitié de ce groupe présentait de sérieux troubles de la parole. C’est une équipe de l’Hospital for Sick Children (« Hôpital des enfants malades »), à Londres, dirigée par Jane A. Hurst, qui a découvert cette famille. Quand une anomalie se retrouve dans trois générations successives, les médecins sont en droit de considérer qu’il s’agit d’une pathologie héréditaire. C’est ce qu’ont soupçonné immédiatement Jane Hurst et ses collègues, et ils ont examiné tous les membres de la famille,baptisée KE pour préserver leur anonymat. Et si un trouble du langage est héréditaire, c’est qu’il existe un gène du langage, c’est-à-dire qu’une partie de l’ADN de l’individu est responsable de l’apparition du langage au cours du développement. Dès que le caractère héréditaire des troubles constatés fut confirmé, l’équipe de Londres a publié cette découverte sensationnelle, en avril 1990, dans la revue scientifique Developmental medicine and child neurology (volume 32, fascicule 4, pages 352 à 355). L’article est signé par Jane A. Hurst, M. Baraitser, E. Auger, F. Graham et S. Norell.
Le titre est : An extended family with a dominantly inherited speech disorder (« Une famille étendue avec un désordre du langage hérité dominant »).
On n’en est plus maintenant à des considérations intuitives comme chez Herder ou Rousseau. Il y a, dans les chromosomes des humains, un « objet observable », moléculaire, dont le bon fonctionnement permet les aptitudes langagières. On pense bien qu’après la parution de l’article de Hurst et de ses collègues, d’autres chercheurs vont se précipiter sur le sujet.
C’est ainsi que dès le mois de février 1998, une équipe de généticiens du Wellcome Trust Center for Human Genetics, un centre de recherche de l’Université d’Oxford, peut annoncer la découverte du gène du langage, qu’elle baptise « SPCH1 ». Cette équipe, composée de Simon E. Fisher, de Faraneh Vargha-Khadem, d’Anthony P. Monaco et d’autres chercheurs, publie, dans la revue Nature Genetics: Localisation of a gene implicated in a severe speech and language disorder. Le gène en question est localisé sur le chromosome n° 7. Les travaux se poursuivent à Oxford, et je ne puis citer toutes les publications qui paraîtront à ce sujet. Il y a notamment, en août 2000, un important article signé par Cecilia S. Lai, Simon E. Fisher, Jane A. Hurst, Faraneh Vargha-Khadem, Anthony P. Monaco et d’autres : The SPCM
region on human 7g31: a genomic characterization of the critical
interval and localization of translocations associated with speech and
language disorder (American Journal of human genetics).
En 2002, les travaux sur le sujet prennent une autre dimension. Une équipe de l’Institut Max Planck, à Leipzig, étudie le «gène du langage » non seulement chez l’homme, mais chez le chimpanzé, le gorille, l’orang-outan, le macaque, et chez d’autres mammifères. Le travail est fait en collaboration avec l’équipe d’Oxford. Le gène est présent chez tous ces animaux, mais sa structure chimique est différente chez l’homme. Il est donc clair que, dans l’équipement génétique des primates, il existe un gène qui, à un moment déterminé (et inconnu) de l’évolution a muté pour acquérir la structure présente dans le genre Homo, et permettant à celui-ci de développer l’aptitude au langage. Mais pour que le langage soit possible,
Il est presque certain que d’autres gènes doivent intervenir(les fonctions complexes sont rarement « mono-géniques»).SPCH1 n’est donc pas « le » gène du langage, mais « un » gène du langage.
Les résultats obtenus par l’équipe de Leipzig avec la collaboration de celle d’Oxford paraissent dans le n° 6 900 (volume 418) de la célèbre revue scientifique britannique Nature, daté du 24 août 2002. Les signataires sont Wolfgang Enard, Simon E. Fisher, Cecilia S. Lai, Anthony P. Monaco, Svante Pââbo et d’autres. Le
titre est : Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language (« Evolution moléculaire de FOXP2, un gène impliqué dans la parole et le langage »). Pour des raisons de nomenclature, le gène SPCH1 a été rebaptisé FOXP2.
Tout cela est bien remarquable ! Ce qui est plus remarquable encore, c’est que des biologistes soient parvenus à prélever de l’ADN (la matière dont sont constitués les gènes) sur des squelettes fossilisés d’ Homo neanderthalensis (morts il y a plus de 30 000 ans !). Il y a des différences entre l’ADN de l’homme de Néandertal et celui de l’homme moderne, ce qui était prévisible. En outre, le gène FOXP2 est semblable dans les deux espèces. Ceci prouve —mais à vrai dire les préhistoriens n’en doutaient pas — que l’homme de Néandertal disposait du langage.
La découverte du gène du langage FOXP2 chez un Homo disparu depuis 30 000 ans est une prouesse inouïe de la science du XXI e siècle. Elle éclaire la question de l’origine du langage. Elle est encore loin de la résoudre.
Qu’importe, au fond ? Quelque part, à un certain moment, un groupe d’hominiens a commencé l’aventure de la parole humaine. Bien avant l’apparition des hommes « sapiens» et « neanderthalensis ». Cela aboutira aux milliers de langues actuellement parlées dans le monde. Et il est difficile de contester que, pour les humains, l’invention du langage a changé le monde